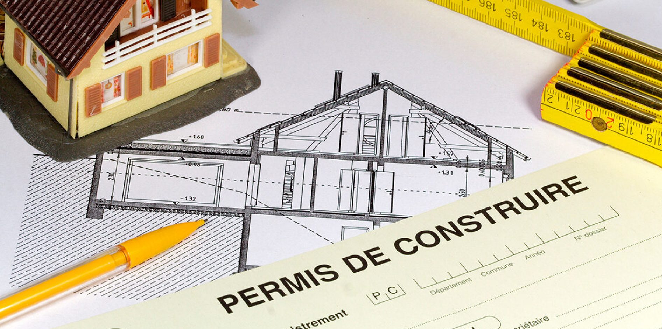Les tensions communautaires au Brakna, en Mauritanie, sont liées à des litiges fonciers qui opposent les populations autochtones, notamment les Halpulareen, aux Haratines installés par l'État dans les années 1980 sur les terres des agriculteurs afro-mauritaniens. En effet, en 1989, l'État, l'État mauritanien a procédé à des expropriations de terres aux dépens des paysans Halpulareen de la vallée du fleuve Sénégal, pour les céder à des Haratines, qui sont en réalité d'anciens voisins des Afro-Mauritaniens, mais qui ont été installés sur ces terres dans le cadre d'une politique de redistribution des terres.
Les protagonistes sont d'anciens voisins qui se connaissaient depuis fort longtemps, ce qui rend la situation encore plus complexe et douloureuse. Les litiges fonciers persistent dans la région du Brakna, notamment à Diatar, Darel Barka, Raneré, Olo-ologa et Abdallah Diéri, où les populations autochtones, qui se considèrent comme les propriétaires légitimes des terres, sont en conflit avec les Haratines installés sur ces terres.
À Raneré, dans la commune de Darel Barka, la situation est plus que triste : le village a été rasé et en lieu et place est érigé un aménagement agricole qui profite aux Haratines installés par l'État. Les populations autochtones ont été déplacées et privées de leurs moyens de subsistance, ce qui a entraîné une grande pauvreté et une insécurité alimentaire.
L'élite Haratine doit agir et s'impliquer davantage en encourageant les siens à respecter les droits de propriétés de leurs concitoyens et à rechercher des solutions pacifiques et équitables. L'Islam interdit la spoliation et l'injustice, et il est important que les religieux et les leaders musulmans prennent position pour condamner ces pratiques et encourager la réconciliation et la justice.
L'État mauritanien a également un rôle important à jouer dans la résolution de ces conflits, en garantissant les droits des populations autochtones et en promouvant la justice sociale et économique.
Pour résoudre ces tensions, il est essentiel de promouvoir le dialogue et la concertation entre les communautés, ainsi que de mettre en place des mécanismes de gestion équitable et transparente des terres. L'organisation d'un dialogue entre les protagonistes est une étape essentielle pour résoudre ces conflits.
Les leaders religieux et les organisations de la société civile pourraient jouer un rôle important dans la préparation du dialogue, en expliquant les principes explicites de l'Islam qui interdisent la spoliation et en encourageant les parties à participer au dialogue. Le dialogue devrait avoir lieu dans un lieu neutre, où les parties se sentent à l'aise et en sécurité.
Les leaders religieux et les organisations de la société civile pourraient jouer un rôle de facilitation pour aider les parties à communiquer et à trouver des solutions. Les parties devraient travailler ensemble pour trouver des solutions qui soient justes et équitables pour tous.
Enfin, l'État mauritanien devrait garantir les droits des propriétaires fonciers et des autres communautés affectées, fournir un cadre juridique clair pour la résolution des conflits fonciers et soutenir le dialogue et la réconciliation entre les parties.
Le problème foncier, autrement dit les terres spoliées aux paysans afro-mauritaniens au profit des Haratines, est un des points du passif humanitaire et son règlement nécessite une volonté de l'État. Il est impossible de régler ou de solder le Passif humanitaire sans résoudre le problème foncier.
Yahya Niane