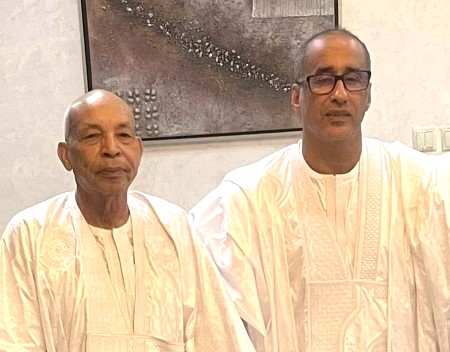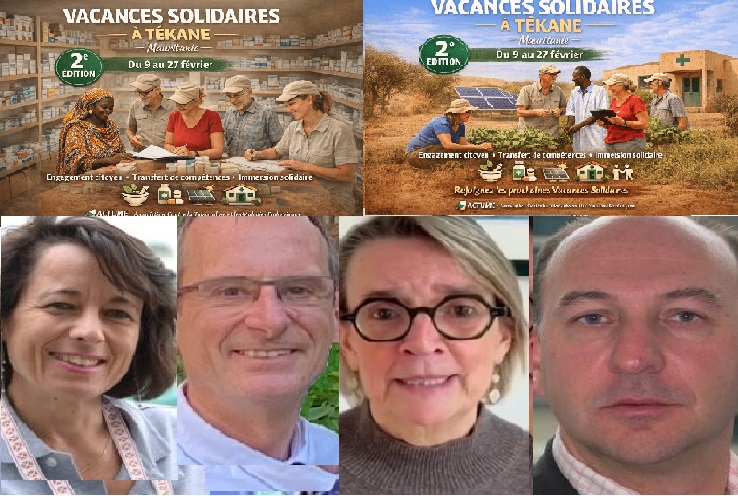La situation qui prévaut actuellement au point de passage de Rosso, à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, soulève une inquiétude croissante tant sur le plan humanitaire que diplomatique. Depuis plusieurs jours, des dizaines de migrants expulsés de Mauritanie, principalement originaires de Guinée, du Mali et du Ghana, se trouvent bloqués dans une zone à proximité du fleuve sans possibilité de traverser vers le Sénégal.
Les autorités sénégalaises, rompant avec la pratique antérieure, ont décidé de n’accepter que leurs ressortissants, refusant désormais de recevoir des migrants d’autres nationalités. Cette position, si elle persiste, pourrait avoir des conséquences graves : tensions bilatérales, crise humanitaire localisée, déstabilisation régionale et atteinte à l’image des deux pays en matière de respect des droits humains.
Le problème est d’autant plus complexe que de nombreux migrants, dans une stratégie délibérée de dissimulation, détruisent volontairement leurs documents d’identification afin de rendre difficile, voire impossible, leur expulsion vers un pays précis. Cette pratique complique considérablement le travail des autorités, qui peinent à établir les identités et les nationalités réelles des individus concernés. Il arrive même que certains ressortissants sénégalais, dans l’espoir d’échapper à une reconduite rapide ou d’être réacheminés ailleurs, déclarent une autre origine. Cette situation crée une confusion totale au poste frontalier et nourrit la méfiance entre administrations, chaque pays redoutant de se voir imposer la charge de migrants qui ne sont pas les siens.
À cela s’ajoute une problématique structurelle majeure : la porosité de nos frontières et l’absence d’un système d’enregistrement fiable des entrées et sorties. Beaucoup de migrants pénètrent sur le territoire mauritanien sans contrôle rigoureux, en raison de la faiblesse des dispositifs de surveillance ou de l’existence de points de passage non officiels. Cette situation rend extrêmement difficile, voire impossible, pour les autorités mauritaniennes de prouver aux pays voisins que les migrants refoulés sont effectivement passés par leur territoire. Cela alimente le refus de certains États, comme le Sénégal, d’en assumer la responsabilité, en l’absence de preuves formelles de leur départ depuis leurs propres frontières.
C’est précisément pour faire face à ce type de défi que j’avais proposé, dans une tribune publiée sous le titre "La Mauritanie face aux périls transfrontaliers : l’urgence d’un système de surveillance avancé", la mise en place d’un dispositif de contrôle intégré et technologiquement avancé à nos frontières. J’y exposais que la souveraineté nationale repose avant tout sur la capacité d’un État à maîtriser ses frontières, et que la Mauritanie, confrontée à une intensification des trafics, des infiltrations criminelles et de la pression migratoire, ne peut plus se permettre de laisser ces brèches ouvertes. Je réitère aujourd’hui, plus que jamais, mon appel à nos autorités pour qu’elles examinent cette question avec sérénité et responsabilité. Il est temps d’aller vers une solution structurée, capable non seulement de protéger notre territoire, mais aussi de doter l’État de moyens de négociation crédibles face à ses partenaires frontaliers.
Il devient donc impératif de mettre en place un système intégré de contrôle basé sur une coordination transfrontalière stricte : toute entrée sur le territoire mauritanien via une frontière officielle ne devrait être autorisée qu’après vérification que les autorités de l’autre rive ont bien enregistré la sortie du migrant. Ce double enregistrement, assorti d’un échange de données en temps réel, rendrait impossible les démentis ultérieurs et établirait clairement les responsabilités de chaque pays en matière de gestion des flux migratoires. Il s’agirait d’une avancée majeure, réduisant considérablement les tensions politiques et les incompréhensions diplomatiques.
Une solution immédiate pourrait également résider dans la mise en place d’un mécanisme bilatéral de concertation entre les autorités sénégalaises et mauritaniennes à Rosso, à travers une cellule conjointe de gestion des flux. En parallèle, l’installation de centres d’accueil provisoires en territoire mauritanien, avec le soutien d’organisations internationales comme l’OIM et le HCR, garantirait un encadrement digne des expulsés en attente d’identification ou de réadmission dans leurs pays d’origine.
Pour aller plus loin, il serait pertinent d’envisager un protocole multilatéral au sein de la CEDEAO, spécifiant les conditions de réadmission des migrants irréguliers entre États membres, en tenant compte des principes humanitaires et du droit international. La mobilisation des missions consulaires des pays concernés pourrait par ailleurs faciliter l’identification et l’organisation des retours volontaires, en allégeant la charge pesant sur les autorités locales.
Enfin, la saisine de l’Union Africaine en tant qu’organe de médiation pourrait offrir un cadre de dialogue élargi, capable de prévenir les malentendus et de maintenir l’esprit de coopération entre États voisins. À plus long terme, des campagnes d’information ciblées sur les dangers de la migration irrégulière et les voies légales de circulation pourraient contribuer à limiter ces afflux et à renforcer la prévention.
Ce qui se joue aujourd’hui à Rosso dépasse une simple question de frontière : il s’agit d’un test pour la solidarité régionale, la gestion humaine des migrations, et la capacité des États à privilégier le dialogue à la confrontation. Ignorer cette crise reviendrait à prendre le risque d’un engrenage incontrôlable, avec des répercussions sur la stabilité sociale et politique de toute la région.
Haroun Rabani